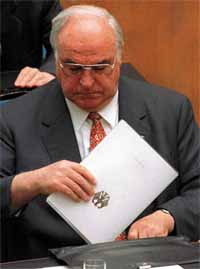|

Au sommet d’Amsterdam, la France a parlé “d’une
seule voix” - mêmes positions pour Chirac et Jospin.
|

Jospin, Chirac et Wim Kok, Premier ministre néerlandais.
|
|

Tony Blair et José Maria Aznar ont fait de la bicyclette
dans les rues d’Amsterdam sacrifiant à la coutume locale.
|

Une partie des Premiers ministres européens au
palais royal d’Amsterdam.
|
La bataille de l’euro et de son corollaire “le
pacte de stabilité budgétaire et de croissance” aura été
longue et dure. Le sommet d’Amsterdam qui risquait, en cas de désaccord,
d’ébranler les relations du couple franco-allemand, moteur de l’Union
européenne, avait été précédé
de laborieuses tractations. A Paris, nerf de la contestation depuis l’arrivée
des socialistes au pouvoir, se sont succédé les médiateurs,
certains avec des projets de compromis. L’un présenté par
le Premier ministre néerlandais Wimkok, président en exercice
de l’Union européenne, l’autre par Jacques Santer, président
de la Commission européenne. Tony Blair, Premier ministre britannique
venait pour sa part rencontrer Jacques Chirac sans être concerné
par la polémique sur le pacte de stabilité, puisque la Grande-Bretagne
ne fera pas partie du “premier wagon de l’euro”. Sa bataille à lui
étant “la compétitivité de l’économie et la
flexibilité de l’emploi”. Le point d’orgue de ce chassé-croisé
de personnalités européennes était, sans conteste,
le 69e sommet franco-allemand tenu le vendredi 13 juin au Futuroscope de
Poitiers. Sommet à responsabilité “partagée” entre
Kohl et Chirac, d’une part et Kohl et Jospin, d’autre part.
LA DURE BATAILLE ENGAGÉE PAR LE CHANCELIER
KOHL
Certes, le chancelier Kohl est un vieux routier de la cohabitation qu’il
a déjà connue en France du temps du président Mitterrand,
avec lequel il constituait un tandem harmonieux, mais aussi chez lui où
il gouverne avec une coalition CDU/CSU et FDP. Seulement, la campagne apparemment
anti-européenne de Jospin, qui indiquait que le “super-Maastricht
(était) une concession absurdement faite aux Allemands” et le programme
économique des socialistes l’avaient mis sur ses gardes. La nomination
d’Hubert Védrine, ami personnel de l’un de ses conseillers et européen
convaincu, entouré d’une équipe de pro-Européens occultant
quelque peu l’anti-européen ministre de l’Intérieur Jean-Pierre
Chevènement, devait en principe le rassurer. Tant s’en faut. Le
super-ministre français des Finances, de l’Economie et de l’Industrie,
Dominique Strauss-Kahn (ou DSK) avait jeté un froid à la
réunion des ministres de l’Economie européens tenue au Luxembourg,
quand il avait souhaité rediscuter le pacte de stabilité
et demandé même à ses partenaires européens
“une période d’évaluation”. Le terrain sur lequel avançait
donc Helmut Kohl en venant à Poitiers était miné,
Lionel Jospin réclamant l’adjonction d’un chapitre social au pacte
de stabilité et refusant une Europe uniquement monétaire
qui ne prenne pas en compte les dix-huit millions de chômeurs. Rien
qu’en Allemagne, on dénombre 4,4 millions de chômeurs et,
en France, 3,1 millions. Dans cette optique, il rejoignait même le
président Chirac favorable à une dimension sociale du pacte
de stabilité. Le 69e sommet s’achevait apparemment, sur un constat
d’échec. Mais Paris et Bonn écartaient l’éventualité
d’une crise. Et Jospin annonçait “nous sommes sur la bonne voie”.
Tandis que Kohl inflexible menait une guerre sur plus d’un front. Fragilisé
chez lui, le chancelier Kohl fait l’objet d’une forte contestation due
à la politique de rigueur budgétaire imposée en Allemagne
pour atteindre l’un des critères prioritaires de Maastricht: un
déficit public ne dépassant pas les 3% du PIB. Un trou de
19 milliards de marks dans le budget de 1997 avait incité le ministre
allemand des Finances, Theo Waigel, à recourir - mais en vain -
aux réserves de la Bundesbank: devises et or. Et c’est toute sa
carrière politique que le chancelier a mis en jeu dans la bataille
d’un euro “aussi fort que le deutsche mark”. Et s’il a décidé
de se représenter aux élections de 1998, c’est bien pour
parachever la mise en place de l’euro qui sera lancé le 1er janvier
1999 et, dans les poches des Européens, le 1er janvier 2002.
|

69e sommet franco-allemand à Poitiers:
Kohl, Chirac, Jospin.
|
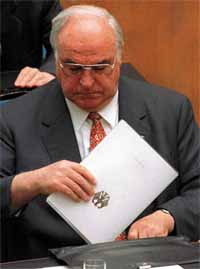
La dure bataille de Kohl a porté ses fruits
|
LE PACTE DE STABILITÉ
Bien que la France, l’Allemagne et divers
pays européens craignent de dépasser les critères
des 3% du déficit du PIB, aucun des pays qui pourrait se trouver
en difficulté ne souhaite le report de l’euro. Ce sont, surtout,
les conditions drastiques du pacte de stabilité qui effraient les
partenaires européens. “Le pacte de stabilité budgétaire
et de croissance avait été adopté par les Quinze,
en décembre dernier, au sommet de Dublin. Il avait été
concocté par le ministre allemand des Finances, Theo Wai-gel, et
l’Allemagne avait mené une rude bataille avant de le faire accepter.
Pour l’Allemagne, il ne suffit pas d’en-trer dans la monnaie unique. Les
élus doi-vent pouvoir main-tenir leur politique de rigueur et ne
pas relâcher leurs efforts afin de ne point affaiblir l’euro. Aussi,
un pacte de stabilité a-t-il été mis au point, prévoyant
des sanc-tions à l’encontre des contrevenants. Les situations budgétaires
seraient soumises à une surveillance constante et reliées
à un système d’alerte rapide. Conditions draconiennes qui
permettraient, entre autres, aux Allemands de ne pas regretter leur mark,
synonyme de croissance. Le système de sanctions a cependant été
adouci, la France ayant réussi à y introduire l’élément
“circonstances exceptionnelles”. Toujours sur une même ligne politique,
le président Chirac affirmait à Tony Blair: “L’Europe, ce
n’est pas seulement une monnaie même si cela est capital, notamment
pour faire face au dollar. L’Europe, ce sont des hommes et des femmes”.
50.000 travailleurs au chômage, après avoir sillonné
l’Europe, étaient venus manifester à Amsterdam, afin que
les Quinze entendent leurs voix. Les Quinze les ont-ils entendus? Le lundi
16 juin, dès les premières heures du sommet mettant fin à
un suspense prolongé, les quinze chefs d’Etat et de gouvernement
ont adopté le pacte de stabilité budgétaire donnant
satisfaction à la France qui a parlé “d’une même voix”
et, à l’Allemagne, qui a maintenu le pacte dans sa formulation initiale.
Un volet économique et social rééquilibrera ce pacte
et fera l’objet d’un conseil européen spécial dans six mois
au Luxembourg, pays qui assure dès juillet la présidence
de l’Union européenne. Si une résolution sur l’emploi a été
adoptée, il n’en demeure pas moins qu’elle ne devra pas entraîner
des dépenses budgétaires supplémentaires, la Grande-Bretagne
appuyant sur ce plan le point de vue de l’Allemagne. Les uns et les autres
affichent leur satisfaction. La France a, surtout, obtenu des promesses
tandis que l’Allemagne a fait passer intégralement son projet.
BEAUCOUP D’AUTRES SUJETS MAIS STATU QUO JUSQU’EN
2002
A l’ordre du jour du sommet d’Amsterdam,
le 17 juin juin, la conférence intergouvernementale (CIG) engagée
en mars 1996 à Turin pour la révision du traité de
Maastricht. Les réformes institutionnelles permettant l’élargissement
de l’UE aux pays de l’Est, la politique de défense commune sujets
de toutes les divergences et de tous les compromis. Après de nombreux
rebondissements et une réunion marathon de dix heures, le sommet
d’Amsterdam s’est, enfin, achevé sur un constat de semi-échec
relatif à tous ces dossiers, à part l’euro, désormais
réalité intangible. La réforme des institutions n’a
pas eu lieu; la révision du traité de Maastricht est reportée
et le statu quo restera en vigueur jusqu’en l’an 2002. Les Quinze ne sont
pas parvenus à s’entendre sur la répartition des voix au
sein d’une UE avec “grands” et “petits” et conservent leurs vingt commissaires.
La Grande-Bretagne a fait obstruction au sujet de la politique de défense
commune, estimant que l’Otan assurait la défense de l’Europe. Un
compromis a pu enfin être élaboré au sujet des accords
de Schengen, notamment sur le droit d’asile accordé aux citoyens
européens. Résumant l’état d’esprit du sommet, Jacques
Chirac a déclaré: “Mon expérience m’a convaincu qu’il
ne faut pas confondre hâte et précipitation. J’étais
pour une révision du traité de Maastricht (dans certains
domaines je suis frustré, dans d’autres satisfait). Mais au total,
c’est un pas raisonnable qui nous met en mesure de commencer l’élargissement
de la communauté, c’est-à-dire à partir de 2001 -
2002, pour recevoir trois à quatre nouveaux membres. Tout cela est
raisonnable”.
|
LES CRITÈRES DU TRAITÉ
DE MAASTRICHT
Etablis par le comité Delors sur décision du sommet européen
de Hanovre en juin 1988, adoptés en décembre 1991 par le
sommet européen de Maastricht, les critères de convergence
économique pour le passage à la monnaie unique, le 1er janvier
1999, sont au nombre de cinq: - Le déficit public ne doit pas franchir
la barre des 3% du PIB. - L’inflation ne doit pas dépasser plus
de 1,5% la moyenne des trois meilleures performances nationales dans l’Union.
- L’endettement public doit être égal au maximum à
60% du PIB. - Le taux d’intérêt moyen à long terme
ne doit pas excéder plus de 2% des trois meilleures performances
nationales. - Les monnaies doivent fluctuer depuis deux ans, au moins,
dans la marge du système monétaire européen.
|
|