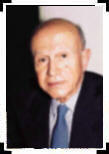Uniquement pour éprouver une sorte de
satisfaction intellectuelle, on peut toujours tirer une leçon des
débats parlementaires. Car sur l’effet pratique de ce genre d’exercice,
il n’y a pas lieu de se faire la moindre illusion: ces leçons, tant
de fois tirées, sous des formes différentes, n’ont jamais
servi à rien. Et actuellement plus que jamais.
Les jeux sont faits. Un moment déboussolée, la fameuse “troïka”
a repris son galop, tirée par le cheval de tête, les deux
autres s’accommodant parfaitement d’une situation où ils ne trouvent
que des avantages.
M. Hariri est comme un roc sur lequel glissent les critiques comme l’eau
sur les galets du fleuve. Rien ne l’ébranle. Il écoute (ou
il n’écoute pas) et conclut toujours: “Tout va très bien;
le char avance”. Tout le reste, à ses yeux, n’est que bavardages
et ragots.
Suprême argument: les témoignages de confiance qu’il reçoit
de l’étranger. La con-fiance des Libanais? Elle ne compte que pour
des prunes.
Sûr de lui et dominateur, selon le mot célè-bre appliqué
à d’autres, en d’autres circons-tances. ***
Le fonctionnement du régime parlementaire libanais est en train
d’évoluer pour ressembler de plus en plus à ce type de conseil
“repré-sentatif” dont les membres sont nommés par les potentats
de la presqu’île arabique pour leur servir de soupape: on s’y exprime
librement dans certaines limites, mais on n’y dispose pas de pouvoirs réels.
Les textes constitutionnels libanais, qui définissent la nature
du régime et son mode de fonctionnement, sont faussés par
une pratique déterminée, elle, par la nature des forces politiques
issues d’un système électoral inadapté.
Peut-on, d’ailleurs, parler vraiment de forces politi-ques? Cette notion
implique l’existence de partis, de programmes, d’une vision cohérente
de l’avenir, du système social et économique, des rapports
du pays avec ses voisins, etc... Ici, rien de tel. Depuis quelques années,
les élections législatives ne portent à la Chambre
que des notables assez fortunés pour donner à l’électeur
le sentiment qu’il sera représenté pour la défense
de ses intérêts locaux ou communautaires et, surtout, pour
obtenir des passe-droits.
Dès lors, le jeu politique entre Exécutif et Législatif
se ramène à un marchandage et se conclut par des com-promis
entre des intérêts personnels. Il marginalise, forcément,
un certain nombre d’irréductibles protes-tataires qui forment une
minorité appelée opposition.
Un chef de gouvernement, sûr de lui-même et de ses propres
objectifs, est naturel-lement porté à ignorer ce type d’opposition
ou à ne lui prêter qu’une oreille dis-traite, par pure complaisance.
La soupape fonctionne ainsi périodiquement à la faveur de
deux ou trois jours de débats parlementaires qui ne sont que des
monologues, sans autre objet que de donner l’illusion d’une démocratie
parlementaire.
C’est ce qu’on appelle dans certains pays du Sud-Est asiatique “une démocratie
surveillée”. Un euphémisme pour camoufler le pouvoir autoritaire
d’une ploutocratie. ***
La confessionnalisation galopante de la vie politique libanaise laisse
peu d’espoir d’une évolution différente. Jadis, le jeu politique
se déroulait entre deux ou trois coalitions interconfessionnelles
et interrégionales (les “Blocs”). Le fonctionnement du régime
pouvait, alors, ressembler à un système de démocratie
parlementaire du type classique. L’évolution aurait dû se
produire de manière à faire émerger de vrais partis
laïcs à partir de ces coalitions. La crise de 1958 a bouleversé
ce schéma dont la ruine s’est achevée à la faveur
de la guerre de 1975-1990.
Dès lors, derrière une façade électorale, on
ne parle plus que de “troïka” et d’arbitrage exercé d’au-delà
des frontières. Les quelques notables qui se regroupent et élèvent
encore la voix pour tenter de redresser le cours des choses, ne font qu’agiter
du vent.
Pour M. Hariri, ils empoisonnent inutilement l’atmosphère.
Pour d’autres, ils ont, au moins, le mérite de maintenir vivante
l’idée d’une véritable démocratie parlementaire et
une exigence de rigueur morale dont l’absence se fait dramatiquement sentir
dans la gestion de l’Etat.
Quant à savoir comment, à quel moment et par quel processus
cette idée pourra être traduite dans la réalité
et dans la pratique, c’est pour l’instant une véritable énigme.
L’éducation que reçoivent les nouvelles généra-tions
les prépare-t-elle à trouver la solution? Rien n’est moins
sûr, hélas!
Ainsi donc, M. Hariri, aujourd’hui, n’a pas à s’en faire. Et qui
donc a dit qu’il éprouvait ce genre de souci?
Il n’y a qu’à admirer sa mine épanouie pour garder confiance
dans la “troïka”.
|
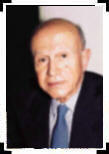
|