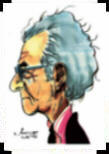Le
choix du Liban pour la tenue du 9ème sommet de la francophonie est,
certes, une réussite. Il est grand temps que ce pays plébiscité
comme un haut lieu de l’esprit, retrouve sa place dans le concert des Nations.
La francophonie a, certes, ses institutions, ses associations, ses
sommets et son histoire. Cependant, qu’est-ce que la francophonie? Que
cache-t-elle? Les 52 pays qui ont le français en partage, le partagent-ils
réellement?
Le mot francophone est certes né avec le géographe Onésime
Reclus en 1880, pour désigner un ensemble géographique défini
par l’usage de la langue française. Depuis, la notion de francophonie
s’est considérable-ment enrichie, pour devenir un concept et une
réalité en plein développement.
Si dès 1962, Léopold Senghor donna rigueur et éclat
à la francophonie en l’assimilant à un humanisme intégral
qui se trame autour de la planète, la comparant à une symbiose
des énergies dormantes de toutes les consciences, de toutes les
cultures qui se réveillent à leur chaleur complémentaire,
Charles Hélou en 1972, étant à la tête de la
francophonie devait rappeler éloquemment et sans équivoque,
“que l’important n’est pas de parler une langue commune mais de parler
un langage commun”. Paroles que le président François Mitterrand
allait répéter à l’ouverture de la dixième
session du Haut Conseil de la francophonie le 22 mars 1994. Il faudra attendre
jusqu’en 1986 pour qu’un nouveau compromis permette la tenue à Paris
de la première conférence des chefs d’Etats et de gouvernements
des pays ayant en commun la langue française et c’est précisément
cette diversité géopolitique qui fait l’intérêt
de la francophonie. Riche de cette diversité multiple, elle est
en quelque sorte un microcosme où les francophones peuvent découvrir,
observer, étudier dans la langue qu’ils maîtrisent, presque
tous les aspects de la réalité planétaire et des relations
internationales. Elle se veut notamment comme un laboratoire de la coopération
Nord-Sud. Facilitée par l’usage d’une même langue, la coopération
francophone met à la disposition des pays membres les moins avancés,
des moyens financiers, techniques et humains dans tous les secteurs du
développement: éducation, formation, démocratisation,
état de droit, industries de la culture, de la langue, de la communication,
agriculture, énergie, environnement, pour ne citer que ces domaines.
***
La francophonie qui se conçoit elle-même un modèle
de pluralité solidaire est, sans doute, appelée à
jouer par la voix de son secrétaire général Boutros
Ghali, un rôle important sur l’échiquier mondial. En élisant
une personnalité d’envergure internationale, la francophonie devrait
saisir une nouvelle chance de s’imposer et de faire entendre une autre
voix que celle de l’Amérique sur la scène mondiale. Cette
révolution culturelle aura plus d’importance qu’on ne lui en prête
actuellement dans les médias, à l’heure où le français
est menacé au sein même des instances européennes,
supplanté par l’anglais en Afrique, où les Etats-Unis multiplient
les ouvertures d’universités; à travers le monde la francophonie
devrait retrouver sa dimension planétaire aussi élevé
que puisse en être le prix. S’agit-il de vaines espérances?
Certes non!
Forte actuellement de ses 52 Etats membres, elle représente
près d’une voix sur quatre dans l’Assemblée générale
des Nations-Unies, ce n’est pas peu. Cependant, comme toutes les communautés
internationales, la francophonie qui n’a effectivement que dix ans d’âge,
est encore à la recherche d’un équilibre difficile à
trouver entre solidarité et concurrence. Puisse-t-elle y arriver
de sitôt. Le génie d’Onésime Reclus d’avoir pressenti
la possibilité d’une communauté culturelle et politique d’envergure,
devrait servir d’école.
C’est aux esprits les plus éclairés du monde francophone,
la France en premier, de ne pas subir les diktats d’où qu’ils viennent,
fussent-ils culturels, économiques ou politiques. Il est fondamental
que le monde francophone s’entende non seulement sur certains principes,
mais sur leur application, afin d’aborder le troisième millénaire
avec une énergie renouvelée à tous les égards.
Dans un monde où beaucoup de peuples souffrent des méfaits
de l’hégémonie anglo-saxonne, la francophonie apparaît
pour eux comme un espace de liberté et de qualité.
En fait, ce qui gène les Anglo-Saxons, c’est plutôt la
latinité, cette autre vision pertinente de l’homme, de sa dignité
et de sa valeur transcendante.
Pour réussir cette entrée dans le XXIème siècle,
la francophonie devrait être à l’écoute des autres,
tout en étant capable de répondre, également, sur
le plan de la culture, de la technologie et du développement, à
une demande impressionnante, capable surtout de répondre à
la mondialisation des aspirations démocratiques, n’en déplaise
au séparatiste Désiré Kabila qui, à son “clanisme”
défendant, a boycotté le sommet de Hanoï.
En effet, la chance de la francophonie se trouve au cœur même
des valeurs et des idéaux à partager. Imaginons ce que la
culture française a apporté dans chaque pays francophone
et ce que les pays francophones ont apporté à la littérature
française. A ce stade enrichissant, le Liban a toujours servi de
modèle et d’avant-garde.
Les pays francophones n’ont aucun intérêt à être
américanisés, à subir de façon excessive l’univers
de la consommation à l’américaine, non plus l’avilissement
suscité par le fondamentalisme à outrance. Les valeurs défendues
par la communauté francophone se veulent des valeurs de tolérance,
d’humanisation, si importantes pour les fondements des sociétés
et des dialogues des cultures. Bref, la francophonie de demain doit être,
surtout, et d’abord une réalité plurielle qui aura l’avantage
de vivre à la fois, l’unité et la diversité, ce qui
au fil du temps lui permettra d’élaborer une vision du monde bien
différente.
Que les francophones, sachent également, profiter de l’expérience
française, assemblage privilégié de réalisations
et d’inventions depuis plusieurs centenaires, véritable espace d’aspirations
civilisatrices et humaines. Que la francophonie sache profiter à
son tour de l’expérience de toutes ses composantes, de ces nombreuses
nations avec qui elle doit entretenir des relations étroites, afin
de créer avec elles de nouvelles synthèses, de nouvelles
créativités promotrices et ambitieuses.
L’un des défis du XXIème siècle pour cet espace
francophone, consiste donc à s’unir autour de la culture française,
qui protègera d’abord et stimulera, ensuite, le développement
des langues et des cultures franco-phones. N’est-ce pas de l’unité
que jaillira la diversité enrichissante? Plus nous serons curieux,
plus nous réussirons notre entente au troisième millénaire
et au delà, car la réussite ne passe pas par un repli sur
soi-même, mais s’accompagne au contraire d’une reconnaissance mutuelle
de l’universalisme dans le respect des spécifités de chacun
et de sa culture. Il y va de notre raison d’être et de notre survie
dans un monde en perpétuelle mutation. |
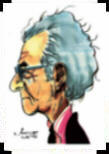
“L’important n’est pas seulement de parler une
langue commune, mais de parler un langage commun”.
Charles Hélou
|