

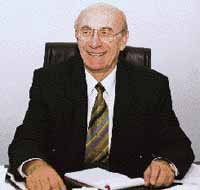


UN CENTRE CULTUREL ET ÉDUCATIF
On découvrira, désormais, une partie des trésors
du musée dans le sous-sol, à travers 26 sarcophages anthropoïdes
de la collection Ford de Saïda et 75 grands objets au rez-de-chaussée:
sarcophages, statues, fresques, stèles, mosaïques etc... Les
mêmes que par le passé, mais exposés dans un contexte
scientifique rénové qui illustre “une nouvelle conception
du musée qui n’est plus un lieu d’attraction pour les touristes,
mais un centre culturel et éducatif“ comme l’indique Camille Asmar,
directeur général des Antiquités.
C’est l’équipe du Musée national composée de Suzy
Hakimian, Anne-Marie Afeiche, Isabelle Skaff et leurs collaborateurs qui
a créé, sous la direction de M. Asmar et avec l’assistance
du Musée de France, ce nouveau concept du musée national,
avec notamment la mise en valeur de son architecture intérieure.
“Tous les revêtements muraux ont été éliminés,
la pierre remise à l’état initial et les deux salles arabes
converties l’une en lieu de projection doté d’un système
audiovisuel relatant l’histoire du Musée; l’autre en vestiaire,
boutique, billetterie, explique M. Asmar qui révèle, en outre,
que le système de sécurité intérieure et extérieure
est assuré avec “l’aide si précieuse“ de l’Armée et
de ses conscrits.

“UN RÊVE QUI A TRAVERSÉ PLUSIEURS
GÉNÉRATIONS”
“Un travail de ruche“ a mobilisé d’immenses énergies
aux divers stades de la restauration. Pour le ravalement et la réfection
des façades extérieures, un budget de 950 millions de L.L.
a été alloué par l’Etat à la Direction générale
des Antiquités (DGA) qui l’a mis à la disposition du CDR,
lequel en a assuré l’adjudication. La remise en état de ces
façades s’est faite avec la pierre ocre qui pouvait s’intégrer
dans la pierre calcaire originale qu’avait choisie en 1937 l’architecte
Antoine Nahas, lorsqu’il entreprit la construction, dans le style égyptien
en vogue à l’époque, la construction du Musée national.
Le rêve d’un tel édifice avait traversé plusieurs
générations et s’était précisé dès
le 10 décembre 1926 avec la formation sous le patronage du président
de la République, d’un Comité des amis des musées
nationaux. Ouvert au public en 1938, le Musée fut inauguré
officiellement en 1942.
La DGA a travaillé en coopération avec la Fondation du
patrimoine présidé par Mme Mona Hraoui pour le réaménagement
intérieur du Musée. La première a détruit toutes
les chapes de béton qui enveloppaient les objets, décapé
les murs, procédé au nettoyage des lieux. La seconde a assuré
les travaux de réfection: peinture, carrelage, toiture de verre,
scénographie (réalisée par M. Villemotte), panneaux
d’exposition, associant à ses efforts les services gracieux de la
société As-Said et de multiples donateurs.
“Ce n’est qu’une phase temporaire, relève Camille Asmar. Nous
devrons parvenir à ouvrir tous les étages. La réfection
du sous-sol n’est pas achevée, il faudra en refaire tout l’inventaire,
l’informatiser. Et c’est déjà énorme. La remise en
état de l’étage supérieur en plus de celle du rez-de-chaussée
est déjà achevée. Nous continuerons le travail après
le 26“.

UN LONG PARCOURS
Camille Asmar parle avec la rigueur d’un scientifique. Il connaît
son métier et il s’y passionne depuis si longtemps. Confirmé
en 1992 au poste de directeur général des Antiquités,
il en avait assuré l’intérimat dès 1983 à la
suite du départ à la retraite de l’émir Maurice Chéhab.
C’est avec ce dernier qu’il a effectué dès 1963 son parcours.
Il a fallu qu’il se présente à un concours organisé
par le ministère de l’Education nationale en vue d’entrer à
la DGA, en qualité d’architecte-restaurateur, pour que tout commence.
Il avait en poche son bac mathélem à la sortie du collège
du Sacré-Cœur et le voici sorti premier, détenteur d’une
bourse lui ouvrant pour cinq ans les portes de la faculté d’architecture
à l’Université de Rome.
Il retrouve en 1963 l’émir Maurice sur les chantiers de Tyr,
Balamand, Jbeil et c’est de nouveau, muni d’une bourse de l’Unesco, le
départ en 1967 pour l’Italie où il se spécialise dans
la restauration des monuments. La route est toute tracée. Il s’y
engage jusqu’au bout, prenant la relève de l’émir Maurice
qui avait fait du Liban pendant soixante ans un immense chantier.
“Il était le premier dit Camille Asmar. Nous continuons son
œuvre.“
| Si le Musée national a réussi à
conserver ses trésors et qu’il se trouve en mesure d’en exposer
une partie au public, il le doit principalement à l’émir
Maurice Chéhab, à son génie, à ses connaissances
monumentales, à sa prodigieuse imagination et à son immense
dévouement.
Les démons de la guerre n’ont pu avoir raison de l’émir Maurice Chéhab ni des trésors qu’il avait commencé à conserver bien avant la construction du Musée national. Avec lui, le Liban était devenu un immense chantier à ciel ouvert où les cités antiques exhumaient, des profondeurs de la terre, les différentes strates d’une civilisation six fois millénaire et donnaient à Tyr, grandiose et sublime, la place d’honneur. Dès le début de la guerre en 1975, l’émir Maurice, secondé par son admirable épouse Olga, surnommée la “doctora” par les Syriens, commence à réunir les objets précieux (bijoux, haches d’or) du premier étage du musée dans des boîtes scellées à la cire rouge, les plaçant dans un coffre-fort pour les déposer à la Banque centrale. Seconde étape: l’émir songe, après avoir préservé l’importante collection d’archives historiques, à emmurer d’autres objets précieux et effectue avec le gardien du musée un véritable travail de maçonnerie, malaxant le béton et fermant les petites lucarnes, accès et porte d’entrée où furent placés ces objets. Il fait, ensuite, couler une dalle de béton sur toutes les mosaïques internes et entourer de sacs de sable tous les sarcophages. Et quand les sacs de sable sont retirés pour être utilisés dans les retranchements des forces armées, il fait poser de grosses lattes de bois cerclées de fer autour de ces sarcophages, les remplace par des blocs de béton et fait acheminer les sculptures transportables vers les dépôts. Ultime recours, le béton armé pour préserver définitivement les sarcophages et les sauver des bombardements israéliens de juin 1982. Tout ce travail s’est effectué sous les tirs et les bombardements dans des conditions héroïques, avec des ouvriers de la première heure. Juste pour conserver la mémoire d’un pays et d’un peuple. Le 24 décembre 1994, l’émir Maurice Chéhab nous quittait pour l’éternité avec laquelle il avait déjà été confronté pendant plus de soixante ans. |