
Initiation des élèves à l’informatique.

Terrain de sport: l’entraînement du
corps complète celui de l’esprit.

Initiation des élèves à l’informatique. |

Terrain de sport: l’entraînement du corps complète celui de l’esprit. |
PROJET INITIÉ EN 1992
Il a fallu attendre la fin de la guerre au Liban et le retour au calme
pour voir se réaliser les différentes propositions, maintes
fois avancées, d’une réforme éducative: un programme
d’éducation nationale réunissant tous les Libanais. C’est
l’idée de départ d’un projet initié en 1992 et entériné
le 17 août 1994 en Conseil des ministres, visant à la formation
d’un citoyen éduqué et productif, capable de raisonner, d’argumenter
et d’acquérir une autonomie du savoir. Il formera ainsi le noyau
d’une société évoluée, prête à
affronter les défis scientifiques, sociaux et culturels du monde
de demain.
Pour atteindre les finalités susmentionnées, une nouvelle
stratégie éducative est adoptée au Liban. Elle se
propose d’intervenir et d’innover à plus d’un niveau: nouvelle structuration
des années d’apprentissage, refonte du contenu des programmes, révolution
dans la méthodologie de l’enseignement, recyclage des professeurs
et nouveaux procédés d’évaluation. Un ensemble de
réformes judicieusement ciblées faisant l’objet de louanges
mais, aussi, de critiques à plus d’un égard.

Le R.P. Salim Daccache. |
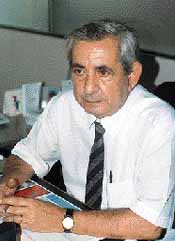
Le Dr Rafic Eido. |
 M. Abdo Kahi. |
STRUCTURE D’UN NOUVEL ORGANIGRAMME
L’un des premiers bouleversements opérés par la réforme
consiste à modifier les différentes phases de l’enseignement
scolaire qui s’étend, désormais, sur quatorze ans et comporte
quatre étapes:
1- Le jardin d’enfants.
2- Le primaire.
3- Le moyen (complémentaire).
4- Le secondaire et ses deux filières:
• Enseignement général.
• Enseignement technique et professionnel.
PRÉ-PRIMAIRE ET ENSEIGNEMENT DE BASE
Longtemps cantonné dans le secteur privé, l’enseignement
pré-primaire ou jardin d’enfants, nouvellement introduit dans le
programme national, doit permettre d’effacer les inégalités
en matière d’années de scolarisation. Les élèves
fréquentant les établissements publics, auront la possibilité
de s’inscrire au pré-primaire dès l’âge de 4 ans révolus.
Cette étape s’étend sur une période de deux ans (1er
et 2ème jardins).
L’adoption d’une telle réforme maintient les trois années
de pré-primaire (petit jardin, grand jardin et 12ème) déjà
en vigueur dans les établissements privés et auxquelles l’enfant
peut accéder dès l’âge de 3 ans.
Dans le nouvel organigramme, le cycle primaire s’étend sur six
ans au lieu des cinq ans adoptés dans l’ancienne structure. Il se
répartit en deux modules de trois années chacun débouchant,
directement, sans examen officiel, sur le complémentaire. Le premier
module est consacré à la découverte de connaissances
multiples (linguistiques, scientifiques, sociétales, artistiques...),
tandis que le second s’applique à la consolidation et à l’approfondissement
de ces acquisitions.
L’adjonction d’une année supplémentaire à l’enseignement
du primaire se révèle particulièrement bénéfique
aux effectifs qui abandonnent l’école à la fin de ce cycle.
En effet, selon des études publiées par l’UNESCO, les chances
de retour à l’analphabétisme sont moindres pour ceux qui
totalisent au moins cinq ans de scolarisation.
Le cycle moyen, ou complémentaire, comporte un module de trois
ans au lieu de quatre, précédemment. Il constitue avec le
cycle primaire un tronc commun d’apprentissage, désigné sous
le nom d’enseignement fondamental ou de base, au terme duquel l’élève
est soumis à un examen officiel pour l’obtention du diplôme
du brevet. Ces neuf ans d’enseignement (primaire et complémentaire)
s’insèrent dans le cadre de la scolarisation obligatoire jusqu’à
l’âge de quinze ans que l’Etat tente, progressivement, d’institutionnaliser.
Les études dispensées dans le cycle moyen constituent
une phase de perfectionnement du primaire mais, aussi et surtout, une étape
préparatoire au secondaire. Le nouveau programme prévoit
des cursus communs à l’enseignement général et l’enseignement
technique, afin de préparer l’élève tant à
l’académique qu’au professionnel et de faciliter son orientation
au niveau du secondaire vers l’une de ces deux filières.
RAMIFICATION GRADUELLE DU SECONDAIRE
Deux filières de trois ans chacune sont donc disponibles dans
le secondaire. La première est placée sous la responsabilité
des écoles techniques de l’enseignement professionnel qui dispensent
des études sanctionnées par un examen officiel: le Bac technique
qui permet à son titulaire de s’orienter, directement, vers le monde
de l’emploi ou vers des instituts techniques et artistiques supérieurs.
La deuxième filière s’insère dans le cadre de
l’enseignement général dispensé par les différents
établissements scolaires et prévoit une première année
de secondaire commune à tous les élèves. Ce “tronc
commun” offre à l’apprenant une chance supplémentaire pour
bien cibler son choix entre les deux options qui lui sont offertes en 2ème
année du secondaire: humanités et sciences.
La principale nouveauté de la 3ème année du secondaire
concerne l’accroissement du nombre d’options et de spécialités
(4 au lieu de 3) toutes sanctionnées par le baccalauréat
général et ouvrant la voie à des études universitaires:
1- La branche des “Sciences Générales” concernant les
mathématiques, les sciences physiques et leur application au niveau
du génie.
2- Les “Sciences de la Vie” à l’instar de la biologie, la chimie
et leur application dans le domaine de la médecine, de la santé
et de l’agriculture...
3- La série “Lettres et Humanités” en relation avec la
langue, la littérature, l’histoire, la philosophie, l’éducation,
les arts, la science religieuse...
4- La nouvelle branche des “Sciences Sociales et Economiques” liées
à la politique, à la gestion, au droit, à la sociologie
et aux sciences de l’éducation...
La création de cette nouvelle option permet, également,
de développer le secteur des services qui occupe, actuellement,
une part de plus en plus grande dans les activités professionnelles
et humaines du monde entier.
Ex-directrice de l’Ecole libanaise de formation sociale pendant treize
ans, Mme Hyam Samaha Kahi participe à l’élaboration du chapitre
relatif au travail social et souligne l’importance de ce bac qui s’insère
dans un double objectif d’ouverture d’esprit et d’orientation professionnelle.
D’une part, il aide les jeunes à comprendre la société
dans laquelle ils évoluent et à casser beaucoup de préjugés.
D’autre part, il favorise leur recrutement dans les domaines du travail
social et des sciences humaines. Les élèves découvriront
dans ce chapitre toute la dimension des problèmes sociaux qui se
posent au Liban, aux plans humain, psychologique et relationnel, au plan
du vécu et non du théorique.
Grâce à ce nouvel organigramme pédagogique, le
Liban s’aligne sur la majorité des pays arabes et étrangers
qui répartissent les années d’enseignement pré-universitaire
de la manière suivante: 6 pour le primaire, 3 pour le complémentaire
et 3 pour le secondaire.
La réforme éducative en vigueur cette année touche,
uniquement, quatre classes: la 1ère année du secondaire,
du complémentaire et de chacun des deux modules du primaire. Elle
fera l’objet d’une révision dans trois ans, afin d’y apporter les
modifications nécessaires, à la lumière des résultats
obtenus. Elle se poursuivra l’année prochaine au niveau des 2èmes
années de chaque cycle.
MÉTHODOLOGIE DE L’ENSEIGNEMENT
La nouvelle méthode pédagogique active, adoptée
par les nouveaux programmes, place l’élève au centre de l’apprentissage.
L’éducation ne se conçoit plus en termes de “transmission
du savoir”, mais plutôt en terme de “suivi”.
Le comportement des enseignants en classe se voit par le fait même
complètement bouleversé. Il leur est désormais demandé
de nouvelles capacités d’écoute, d’observation et de créativité.
Conscient de cette mutation, le CNPRD a organisé des sessions de
recyclage pour les enseignants du secteur public et privé, afin
de les initier aux nouvelles méthodes pédagogiques et les
familiariser avec les nouveaux programmes et manuels.
Toutefois, selon l’expression de M. Abdo Kahi, chercheur en sciences
sociales et enseignant universitaire ayant collaboré à l’élaboration
des nouveaux programmes, comment réussir la formation, en quelques
séances, d’un corps enseignant rodé des années durant
à une seule et unique méthode pédagogique?
Le père Salim Daccache, recteur du collège Notre-Dame
de Jamhour, se plaît à qualifier cette formation de simple
“information”. Un recyclage solide et profond destiné à former
le nouveau profil de l’enseignant moderne, ne peut se concevoir en deux
ou trois sessions d’initiation. C’est un travail de longue haleine pour
lequel les différents établissements scolaires, les bureaux
pédagogiques et les instituts d’enseignement supérieur (relatifs
au secteur public) sont appelés à coopérer.
Le suivi pédagogique prévu par le nouveau programme soulève,
également, un problème d’un tout autre ordre. Il suppose
l’acceptation d’un nombre restreint d’élèves en classe et
l’augmentation, par conséquent, des salles d’études. Or,
le manque de locaux disponibles dans tous les établissements scolaires
pose une sérieuse problématique difficile à résoudre.
ÉVALUATION ET PASSAGE AUTOMATIQUE
Le passage de classe automatique dans le premier module du primaire
et facilité dans son second module, s’insère dans une politique
visant à réduire au maximum l’échec et l’abandon scolaire.
(Un élève ayant doublé à deux reprises sa classe
se voit refuser l’admission dans tous les établissements scolaires).
Deux problèmes se posent à ce niveau. D’une part, l’écolier
rassuré de son succès en fin d’année, risque de perdre
toute motivation quant à l’assiduité au travail.
D’autre part, le père Daccache estime nécessaire de soumettre
la règle de passage automatique à des critères objectifs
et concrets, au lieu d’en faire un usage général et arbitraire.
On dénombre, actuellement, dans le secteur public environ 10%
d’élèves de 11ème pâtissant de difficultés
d’écriture et de lecture.
La solution de ce problème se situerait un peu plus en aval,
au niveau du cycle pré-primaire adopté, récemment,
dans ce même secteur.
Toutefois, le Dr Rafic Eido, directeur général de l’éducation
et de l’enseignement de l’Association des Makassed, lie le passage automatique
au nouveau système d’évaluation. Ce système consiste
à jauger les progrès et acquisitions réalisés
par l’élève au cours de l’année scolaire, en se basant
sur des objectifs et des compétences prévus pour chaque discipline
enseignée.
Supposons, à titre d’exemple, qu’en matière de dictée,
le premier trimestre de l’année pour la classe de 7ème est
consacré à l’étude des accords. A ce moment, la compétence
de l’élève sera évaluée suivant sa maîtrise
de l’orthographe des accords dans une dictée. L’instituteur notera
ses appréciations dans un livret d’évaluation, en cochant
la case relative à la lettre “A” pour “Acquis”, “NA” pour “Non Acquis”
et “CA” pour “en Cours d’Acquisition”.
Ce système s’avère pénible à manier, d’autant
plus qu’il exige une connaissance et un suivi continu de chaque élève,
afin de lui apporter l’aide nécessaire en cas de difficultés.
Cette méthode d’évaluation inspirée du système
canadien et français vise, néanmoins, à situer l’élève
du point de vue de ses connaissances et de ses capacités par rapport
aux objectifs préfixés.
Le bulletin de note limite, par contre, l’élève à
une appréciation numérique non révélatrice
des véritables lacunes de son apprentissage.
REFONTE DES PROGRAMMES SCOLAIRES
La nouvelle stratégie éducative adoptée au Liban
prévoit une réforme totale des programmes d’enseignement.
Objectifs: les relier aux impératifs des progrès socio-économiques
et technologiques, maintenir un équilibre judicieux entre acquisitions
théoriques et applications pratiques, favoriser les cultures nationales
et civiques, développer les compétences manuelles et les
activités sportives, former l’esprit civique, le goût artistique
et le sens esthétique de l’élève.
Pour mener à bien ce projet, les promoteurs de la réforme
ont investi leurs efforts dans la mise à jour des disciplines déjà
enseignées, l’amélioration du livre scolaire national et
l’introduction de nouvelles matières.
L’utilisation de nouveaux manuels élaborés par le CNPRD,
obligatoires pour les établissements scolaires publics, est facultative
pour les écoles privées à l’exception des livres d’Histoire
(voir encadré) et d’éducation civique. Le père Daccache
aurait souhaité que ces deux livres fassent, également, l’objet
d’élaboration et de publication de la part du secteur privé.
Cependant, la pénurie de certains nouveaux livres scolaires
adoptés cette année, due au retard de publication ou à
l’épuisement des stocks, jette une zone d’ombre sur le tableau.
Il serait bon, aux dires du père Daccache, que le CNPRD sonde les
besoins de toutes les écoles en livres scolaires, par le biais de
coupons “question-réponse”, afin d’éviter qu’un tel problème
récidive l’année prochaine.
Aux disciplines de base, dont le contenu a été enrichi
et, peut-être même alourdi, viennent s’ajouter de nouvelles
matières: technologie, informatique, éducation civique, sociologie,
économie, gestion, civilisations, hygiène, environnement...
D’autres activités plutôt récréatives et
artistiques meublent, également, une partie des programmes: sport,
dessin, photographie, sculpture, écriture, chant, musique, danse,
théâtre, travaux manuels, agriculture, arts ménagers,
conduite de voiture...
Cette densité et cette variété de matières,
ayant nécessité une augmentation des heures d’enseignement,
constituent une arme à double tranchant: d’une part, elles répondent
dans leur diversité aux objectifs préfixés par la
nouvelle stratégie éducative, mais risquent, d’autre part,
de stresser des élèves surchargés par un surplus d’information
à gérer.
Serait-ce la reprise du fameux adage: qui trop embrasse, mal étreint?
Le Dr Eido et le père Daccache s’accordent, toutefois, à
dire que les matières à caractère artistique et ludique,
bien agencées dans l’emploi de temps des élèves, leur
offriront un espace de liberté et de divertissement. C’est dans
cette perspective que le collège N.-D. de Jamhour a prolongé
la récréation de midi pour y inclure ces différentes
activités et bien d’autres: peinture sur tissu, tir à l’arc,
pyrogravure, céramique... dans le cadre du “Midiclub”.
La nature des nouvelles disciplines à l’instar de la technologie
et de l’informatique, octroie à l’expérience une place très
importante dans le cursus scolaire. Elle suppose un travail pratique en
laboratoire avec utilisation de logiciel et manipulation de matériel
scientifique, électrique, de mesure ou d’observation.
La mise en pratique de cette politique se heurte à deux obstacles.
Le premier concerne le manque de locaux, ainsi que le financement et le
temps requis à leur équipement. Le second relève du
corps enseignant auquel devraient se rallier de nouveaux éléments
qualifiés recrutés sur concours. Ces problèmes se
posent aux écoles privées et plus lourdement aux écoles
publiques.