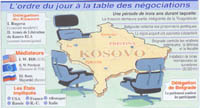RAMBOUILLET, PASSAGE OBLIGÉ
DE LA PAIX EN EUROPE
LES ACTEURS DU DRAME DU KOSOVO
Le cadre du
château de Rambouillet avec ses ors, ses boiseries, ses 22.000 hectares
de chênes, est bien loin de rappeler celui de l’austère base
militaire US de Dayton dans l’Ohio où fut négociée
en novembre 1995 la paix en Bosnie, bien qu’un drame similaire s’y joue
avec les mêmes enjeux, mettant en péril le fragile équilibre
des Balkans et la paix sur le flanc sud-est de l’Europe.

Les forces de police française surveillent
l’enceinte du château de Rambouillet.
|

Le “Foch” croisant en mer
Adriatique et prêt à intervenir.
|

Le président Chirac à Rambouillet:
“La France,
pas plus que ses partenaires, ne tolèrera pas
un conflit
qui bafoue les principes essentiels de la dignité
humaine.”
|

Deux membres de la délégation
serbe,
le vice-Premier ministre Ratko Markovic
(à gauche) et son homologue de la fédération
yougoslave, Nikola Sainovic.
|

Ecoutant le président Chirac, au premier
rang,
Hubert Védrine et Robin Cook, au second rang,
le leader kosovar modéré, Ibrahim Rugova.
|

Le général Wesley Clark, commandant
suprême des forces de l’OTAN en Europe:
L’OTAN est prête à intervenir.
|
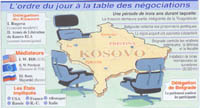
Cliquer pour agrandir
|

Cliquer pour agrandir
|
Ce château du XIVème siècle (à quelque 50
km au sud-ouest de Paris), restauré et aggrandi, a déjà
été le témoin d’événements historiques:
mort de François 1er en 1547 des suites d’une blessure à
la chasse, abdication de Charles X en 1830 et... séjour du général
De Gaulle qui y donna l’ordre à Leclerc, le 23 août 1944,
d’entreprendre sa “marche libératrice” sur Paris. Plus tard, de
ce château, devenu propriété de l’Etat à la
fin du XIXème siècle, De Gaulle fera un haut-lieu des rencontres
diplomatiques, y recevant le chancelier Adenauer, Nikita Khroutchev en
pleine guerre froide, Harold Mc Millan.
Depuis, la tradition ne s’est pas démentie. Les hôtes
prestigieux ont défilé au château avec un temps fort
en novembre 1975, lorsque Giscard d’Estaing y réunit six chefs d’Etat
et de gouvernement des pays les plus industrialisés donnant, ainsi,
le coup d’envoi du G7.
C’est, d’ailleurs, le président Chirac qui a ouvert, le 6 février,
la conférence de Rambouillet, initiée par les six pays du
Groupe de contact (Allemagne, Etats-Unis, France, Italie, Royaume-Uni,
Russie), co-présidée par les chefs de diplomatie française
et britannique, dirigée par trois médiateurs représentant
les Etats-Unis, l’Union européenne et la Russie. “L’Histoire est
dans les mains de quelques hommes”, a observé le président
français. Tel est le cas aujourd’hui pour vous qui prenez place
à la table des négociations.” Et il a ajouté à
l’intention des acteurs du drame (13 Serbes et 16 Albanais): “Quand vous
repartirez, une page de l’Histoire sera tournée. Je vous engage
à faire triompher les forces de la vie sur les forces de la mort.”
En effet, en l’espace de onze mois, 2.000 morts sont déjà
tombés dans le Kosovo, province-sud de la RFY (10.877 km2, 2 millions
d’habitants, peuplée à 90% d’Albanais, ayant perdu en 1989
la large autonomie dont elle disposait depuis 1974). De nouvelles violences
ont même secoué Pristina à l’ouverture de la conférence.
Une bombe de forte puissance explosait dans un centre d’achat et faisait
trois morts. L’attentat sera, d’ailleurs, condamné par les deux
parties qui ont exprimé à Rambouillet “leur regret et leur
indignation”.
Le document de travail, l’accord en vue, l’esprit dans lequel devront
être conduites les négociations prévues pour être
particulièrement âpres et difficiles, ont été
aussi bien définis dans le discours du président Chirac que
dans ceux des ministres des Affaires étrangères français
et britannique, Hubert Védrine et Robin Cook. “C’est la stabilité
de tout le sud-est de l’Europe qui est en jeu”, avait souligné le
chef d’Etat français. “Et nous voulons la paix dans notre continent.”
Cette paix passe, désormais, par le Kosovo. Les protagonistes ont
une semaine pour la définir. Dans le cas où des progrès
seraient enregistrés, ils bénéficieront d’une semaine
supplémentaire.
C’est un projet d’une “autonomie substantielle”, prévu pour
trois ans, qui est offert aux Kosovars. Dans le cadre d’élections
organisées sous contrôle international, ils pourront désigner
leurs représentants et gérer leurs propres structures sanitaires,
éducatives, fiscales, juridiques et policières. Ils devront,
en revanche, préserver les droits des minorités qui les entourent.
Les Serbes qui considèrent le Kosovo comme le berceau de leur civilisation
depuis le XIVème siècle conserveront, outre l’intangibilité
de leurs frontières, le monopole des affaires étrangères
et de la monnaie.
Serbes et Kosovars qui logent dans deux étages différents
du château et ne se réunissent qu’avec les médiateurs,
sont sommés de s’entendre. Mais leurs objectifs sont totalement
divergents. Les Serbes refusent l’interlocuteur “terroriste” que représentent
les membres de l’UCK et rejettent l’autonomie telle que la définit
le projet. Ils refusent, en outre, tout déploiement au sol de troupes
étrangères. Les Kosovars ne demandent rien moins que l’indépendance.
Le dispositif militaire de l’OTAN est prêt à intervenir
en cas d’échec des négociations qui se déroulent à
huis clos. Près de 200 avions et plusieurs navires se trouvent sur
les bases italiennes et en mer Adriatique. Les menaces de l’Alliance atlantique
concernent aussi bien les Serbes dont les objectifs militaires seraient
bombardés, que les rebelles de l’UCK qui seraient coupés
de leurs bases-arrière et de leurs moyens de financement. C’est
dire combien la situation est critique pour les deux parties.
En cas d’accord, une force internationale de 30.000 hommes, à
l’image de la Sfor déployée en Bosnie, sera chargée
de son application sur le terrain. Elle comprendra 6.000 à 8.000
Britanniques, 5.000 Français, 3.000 Allemands, 2.000 à 4.000
Américains, de même que des soldats grecs ou hollandais. Elle
sera commandée par un général britannique, en l’occurrence
sir Michael Jackson qui dépendrait du général américain
Wesley Clark, commandant des forces de l’OTAN en Europe.
Les enjeux sont considérables pour les Européens qui
ont pris l’initiative de cette conférence et tentent d’initier une
politique de défense commune.

Home