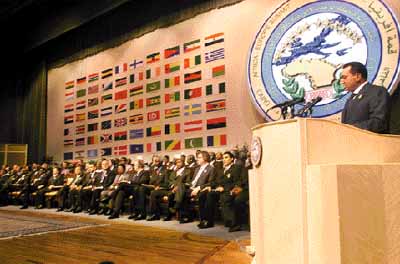
Le président Hosni Moubarak inaugurant le sommet.
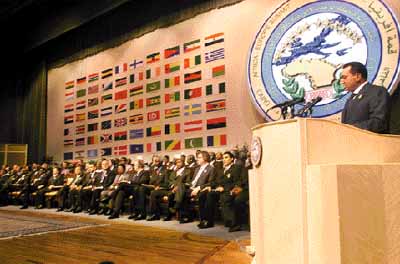
Le président Hosni Moubarak inaugurant le sommet.
Les 3 et 4 avril, une soixantaine de rois, chefs d’Etat, Premiers ministres
des 15 pays de l’UE et de 52 pays africains (la Somalie en proie à
la guerre civile était absente) ont envisagé en commun leur
“partenariat stratégique pour le XXIème siècle”.
Dans ce forum réunissant les deux continents, Jacques Chirac
était le seul président européen, ses pairs s’étant
fait représenter par leur chef de gouvernement ou leur ministre
des Affaires étrangères. Ceux-ci s’étaient déjà
réunis avec leurs experts à la veille du sommet pour achever
la mouture des plans d’action et de la déclaration finale. C’est
dire que les surprises n’étaient pas au rendez-vous. Tout étant
déjà fixé à l’avance.
Bien entendu, la rencontre, avant l’ouverture du sommet, du président
de la Commission européenne Romano Prodi avec Mouammar Kadhafi,
était un événement en soi puisqu’elle constituait
une sorte de réhabilitation de la Libye, objet de sanctions internationales
depuis 1992 (suspendues en avril 1999) pour son soutien présumé
au terrorisme. Cet événement a été terni par
une diatribe du bouillant colonel, lors d’une réunion de travail
à huis clos, contre la France et le Portugal qui, dans son optique,
n’ont ni à donner de leçons à l’Afrique ni à
lui proposer leur assistance. Néanmoins, Kadhafi qui s’est imposé
comme la vedette du sommet, a fini par rencontrer plusieurs dirigeants
européens.
Une autre rencontre, précédée d’une accolade lors
de la cérémonie inaugurale, a permis de détendre quelque
peu les relations difficiles du roi du Maroc Mohamed VI et du chef d’Etat
algérien, Abdel-Aziz Bouteflika, président en exercice de
l’OUA (Organisation de l’Unité africaine) en conflit au sujet du
Front Polisario revendiquant depuis 1975 la souveraineté sur le
Sahara occidental, ancienne colonie espagnole.
D’autres rencontres bilatérales ont ponctué ce sommet
qui a consacré la “position géostratégique” de l’Egypte
au niveau du continent africain où elle a parrainé plusieurs
initiatives de paix, ainsi que son rôle proéminent dans le
processus en cours au Proche-Orient. Dans son discours inaugural, le président
Hosni Moubarak a souligné l’interaction des deux continents, car
“un développement durable en Afrique aura des répercussions
positives sur les autres régions du monde en général
et l’Europe, en particulier”. Thème repris par le président
Bouteflika qui a souligné l’intérêt majeur des “immenses
ressources que recèle le continent africain dont l’exploitation
peut être bénéfique à tous. C’est à un
“saut qualitatif” permettant l’adaptation du continent africain aux nouvelles
données de l’économie mondiale et à la poursuite du
processus de démocratisation qu’a invité Romano Prodi, président
de la Commission européenne.
Par-delà l’euphorie des grands discours, la réalité
est ailleurs. Si l’Europe et l’Afrique, l’une parvenue au plein développement,
l’autre en quête éperdue de ce même développement,
constituent deux univers à part, ils convergent vers des préoccupations
et des intérêts communs. Tous se veulent pourfendeurs de la
corruption, respectueux de la démocratie, des droits de l’homme.
Seulement, leur rhétorique se heurte à une interprétation
divergente de valeurs supposées être partagées.
 Gerhard Schröder, Javier Solana, Robin Cook, le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, le chef de l’OUA, Salim Ahmed Salim et au centre, le président très contesté du Zimbabwe, Robert Mugabe. |
 tunisien Zein el-Abidine Ben Ali, Mouammar Kadhafi, le roi Mohamed VI et le président Bouteflika. |
 étrangères serrant la main du président nigérian, Olusegun Obasanjo. |
Si l’Etat de droit se trouve défaillant dans le continent noir,
c’est en raison de la “pauvreté et de la faim”, s’obstinent à
expliquer les Africains qui réclament avec insistance l’annulation
de leur dette évaluée à 350 milliards de dollars.
A ce prix ils sortiront de ce cercle vicieux qui entrave leur développement.
C’est donc en demandeurs qu’ils sont venus rencontrer les Européens.
Ceux-ci leur ont infligé quelques remontrances en les invitant à
gérer correctement les affaires publiques par la prévention
et le combat de la corruption et du népotisme.
En plaçant très haut la barre, les Africains pouvaient
espérer, tout au plus, un allégement de leur dette. Le chef
de la diplomatie autrichienne, Mme Benitta Ferrero-Wagner a bien exprimé
l’impuissance occidentale: une annulation totale de la dette est “bien
au-delà de nos propres moyens”. D’ailleurs, l’absence au forum des
institutions financières internationales telles que le FMI et la
Banque mondiale, ainsi que celle des ministres des Finances ne permettait
pas d’envisager une telle possibilité. L’an dernier, l’UE avait
décidé l’octroi d’un milliard d’euros aux pays pauvres très
endettés (PPTE). Dans son optique, le forum du Caire n’est pas l’enceinte
habilitée à traiter d’un tel sujet. Toutefois, un suivi du
sommet mené par de hauts fonctionnaires pourrait aider les Africains
“ à sortir du cycle de dépendance” dans lequel ils se trouvent.
Sur ce plan, la France a déjà pris quelques longueurs
d’avance en décidant, comme l’a indiqué le président
Chirac, d’annuler “la totalité des créances publiques bilatérales
dues au titre du développement ou au titre des créances commerciales
des pays les plus pauvres et les plus endettés”. Ce qui représente
un effort additionnel de 7 milliards de dollars. “Au total, ajoute le président
français, la France aura annulé, au cours des quinze dernières
années, plus de 23 milliards de dollars en faveur des pays lourdement
endettés”. L’exemple de la France a été quelque peu
suivi par l’Allemagne qui a annoncé sa volonté de supprimer
350 millions de dollars des dettes des pays les plus pauvres. De même
que par l’Espagne qui a annulé une dette d’un montant de 200 millions
de dollars.
L’économique et le politique étant liés, les pays
africains ont proposé, à l’initiative de l’Egypte, “une référence
expresse” du document final “à une zone sans armes nucléaires
au Proche-Orient”. Or, s’agissant d’un sommet qui n’incluait pas les problèmes
du Proche-Orient, a rectifié le ministre belge des Affaires étrangères,
Louis Michel, qui pensait à l’instar de ses homologues néerlandais
et allemand que cette référence visait Israël (en possession
de 200 têtes nucléaires), la demande était irrecevable.
Contrairement à celle relative à “la restitution et (au)
retour dans le pays d’origine de monuments historiques, d’objets d’art
et de biens culturels” africains transférés par les anciens
colonisateurs dans les musées européens. A ce sujet, un compromis
qui n’engage personne a pu être trouvé, réaffirmant
“la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel de l’Afrique”.
Mais les Africains désiraient aller plus loin, en accompagnant
la restitution des biens culturels des fonds détournés vers
des banques étrangères par des ex-dirigeants corrompus. Leurs
partenaires européens se sont montrés prudents évitant
de s’engager sur ces sables mouvants.
A l’horizon de 2003, un nouveau sommet réunira en Grèce
les deux continents. Un nouvel élan a été donné
à leur partenariat aux mouvements contradictoires. Les Africains
attendent de l’Europe ce qu’elle n’est peut-être plus en mesure de
leur donner.