|
A
l’aube du 17 janvier 1991, il y a exactement dix ans, une coalition
internationale menée par les Etats-Unis d’une envergure à
nulle autre pareille, depuis la Deuxième Guerre mondiale, lançait
une offensive aérienne contre l’armée irakienne de Saddam
Hussein qui avait envahi le Koweit le 2 août 1990.
L’opération a porté le nom de “Tempête du
Désert” et a duré six semaines. En ce dixième
anniversaire, l’heure des bilans s’impose, d’autant plus
qu’avec les développements régionaux concernant, surtout, le
conflit israélo-arabe, l’Irak est appelé à jouer un
rôle sur l’échiquier régional. La paix attendue et
tant souhaitée ne pourra se faire sans une solution au problème
de l’Irak soumis depuis dix ans à des sanctions internationales.
George Bush père avait lancé l’offensive contre ce pays le
17 janvier 1991. Dix ans plus tard, George W. Bush, nouveau locataire de la
Maison-Blanche, sera-t-il le champion de la levée des sanctions contre
Bagdad?

|
|
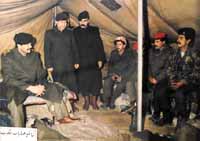
Une photo exposée au
musée de la Victoire à Bagdad montrant le président Saddam
Hussein visitant un camp militaire au Koweit après l’invasion.
|
Dès les premières attaques, un véritable
ouragan s’abattait sur “l’armée de Saddam”,
qualifiée par la communauté occidentale, comme étant la
quatrième armée du monde. Ironie du sort: cette force militaire
avait été équipée par ce même Occident. A
chaque temps, ses impératifs. Les forces de la coalition anti-irakienne
avaient été placées sous le commandement du
général américain Norman Schwarzkopf. Alignant 580.000
militaires, 750 avions, 60 navires de guerre, 1.200 chars et
bénéficiant du soutien d’une trentaine de pays, leur
suprématie était évidente. Au niveau du monde arabe,
l’Egypte, l’Arabie saoudite, les Emirats et la Syrie
s’étaient rangés du côté des alliés
occidentaux. Avec son flair politique, le président syrien Hafez Assad
avait compris, dès le départ, tout l’intérêt
d’adhérer à la coalition. Son attitude avait
été hautement appréciée par Washington qui lui a
laissé les coudées libres au Liban, sa carte maîtresse face
à Israël. Le 13 octobre 1990, l’aviation syrienne bombardait
le palais présidentiel de Baabda pour y déloger le
général Michel Aoun. Les troupes de Damas, envahissaient à
nouveau la région Est, sous le regard impassible de l’Occident et
une surprenante retenue israélienne. Comme toujours, le Liban
était l’éternelle victime de tout conflit proche-oriental.
Il a payé les frais de l’invasion du Koweit par l’Irak et de
la guerre du Golfe.

Le commandant en chef des
forces US, le général Norman Schwarzkopf et le
lieutenant-général Sultan Hachem Ahmed au terme des pourparlers
du 3 mars 1991. |
|

Udaï Hussein,
député et fils du président irakien, a
réclamé une nouvelle carte de l’Irak, englobant le Koweit.
|
DES
RAIDS MEURTRIERS
La “Tempête du Désert” sera
appelée, aussi, “guerre de la CNN” car, par le biais de cette
chaîne de télévision américaine ayant placé
des relais puissants à Bagdad, le monde entier a pu suivre, à la
seconde près, les raids alliés; puis, leur progression sur le
terrain. Les bombardements d’une rare virulence, vont s’acharner tout
particulièrement contre les installations militaires, industrielles et
les positions des troupes irakiennes au Koweit. Le général Kassem
al-Shamri, commandant de la Défense civile irakienne, évoquant
cette guerre a, récemment, déclaré que l’Irak a
été la cible de l’équivalent de sept bombes
nucléaires pareilles à celles qui ont été
larguées sur Hiroshima lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ceci
a été calculé sur la base des 141.921 tonnes de munitions
utilisées contre l’Irak, y compris des bombes à uranium
appauvri. En cette date anniversaire, les témoignages recueillis
à Bagdad par des correspondants de presse sont poignants et expriment
l’impact que la “Tempête du Désert” a produit sur
tout un peuple. Un jeune Irakien de 19 ans affirme: “J’entends
toujours la voix de mon père nous disant: A partir de maintenant, nous
allons dormir dans la même chambre. Ou nous survivrons ou nous mourrons
ensemble”. Une jeune femme de 24 ans confie: “Le bruit des
sirènes annonçant les raids bourdonne encore dans ma tête
et quand j’entends à nouveau ce sifflement, tout mon corps
frémit”.
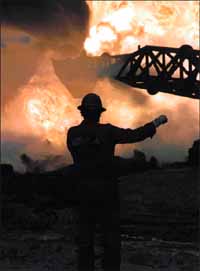
Un puits de pétrole
koweitien en flammes après le retrait des forces irakiennes.
|
|

Les soldats US criant
victoire le 27 février 1991, le jour où les alliés
arrivèrent aux abords de la ville du Koweit. |
OFFENSIVE TERRESTRE
Face aux raids alliés,
Saddam Hussein riposte, lançant des missiles “Scud” sur
l’Arabie saoudite où sont déployées les forces
alliées, sur Bahrein et sur Israël. Son objectif est
d’impliquer l’Etat hébreu dans la guerre, afin de briser
l’alliance arabo-occidentale contre l’Irak. Mais
l’Amérique y veille et l’Etat hébreu est prié de
rester en marge du conflit. Les autorités israéliennes prennent,
cependant, les précautions nécessaires et les masques anti-gaz
sont distribués à la population, par crainte des missiles
à têtes chimiques. L’offensive terrestre est lancée
dans la nuit du 23 au 24 février. Le 26 février, Saddam Hussein
confirme un ordre de retrait du Koweit qui se fait dans le chaos le plus total.
Selon les estimations occidentales, l’Irak a perdu dans cette guerre,
près de 4.000 chars, 2.100 pièces d’artillerie, 240 avions,
1.856 transports de troupes, 50 à 100 mille soldats sur une armée
comptant 350.000 hommes.
À L’HEURE DES BILANS
Au lendemain de l’invasion du
Koweit par l’Irak, le 2 août 1990, le Conseil de
Sécurité de l’ONU avait imposé une série de
sanctions très dures contre le régime de Bagdad, afin de le
contraindre à détruire toutes ses armes de destruction massive.
Ces sanctions ont-elles été efficaces? Sur le plan militaire, des
sources diplomatiques estiment que l’Irak est désarmé
à 95% et n’est plus une menace. N’empêche que, depuis le
départ en décembre 1998, des inspecteurs en désarmement de
l’ONU et le refus par Bagdad d’autoriser leur retour suite à
un conflit avec les Nations Unies, le pays n’est plus soumis à
aucun contrôle. De surcroît, le Conseil de Sécurité
est quasiment paralysé par ses divisions. La coalition anti-irakienne a
cru que la défaite, doublée des sanctions, entraînerait
rapidement la chute du régime de Bagdad. Mais, dix ans après,
Saddam est toujours en place, refusant de plier, malgré l’embargo
et a pris du poil de la bête depuis l’Intifada palestinienne
d’Al-Qods. Il exprime son appui aux Palestiniens et sa
disponibilité à envoyer des soldats se battre à leur
côté. Il joue, à nouveau, sur la fibre de la
solidarité arabe face à Israël et aux Etats-Unis. Le 31
décembre, il a même organisé un imposant
défilé militaire à Bagdad le premier de cette ampleur
depuis la guerre et son fils Oudaï vient de rappeler, une fois de plus,
que “le Koweit fait partie intégrante de l’Irak”.
L’embargo aérien imposé par l’ONU, lui aussi s’est
effrité, tel qu’on a pu le constater ces derniers mois avec une
multitude de vols vers Bagdad à caractère humanitaire,
médical ou socio-économique. De même, plusieurs pays
renforcent leurs relations économiques avec l’Irak, à
commencer par les pays de la région. Le rapprochement entre l’Irak
et la Syrie longtemps “frères ennemis”, est très
significatif. L’Egypte s’ouvre sur Bagdad.
CONDITIONS DE VIE DIFFICILE
Les sanctions et
l’embargo ont eu, par ailleurs, un effet dramatique sur les conditions de
vie des 22 millions d’Irakiens, en dépit du programme
“pétrole contre nourriture”. Selon les autorités de
Bagdad, l’embargo est responsable de la mort de plus d’un million
d’Irakiens à majorité des enfants, faute de
médicaments et de nourritures. Et Saddam a bien mené sa
propagande à ce niveau, montrant constamment sur le petit écran
le défilé des cercueils blancs d’enfants victimes du blocus.
Mais selon le témoignage d’un diplomate occidental, “la
situation a totalement changé ces deux dernières années:
les marchés regorgent de marchandises, des voitures neuves sont visibles
partout et l’embargo aérien s’est pratiquement
effondré”. Quant au député Salem al-Qobeissi, chef de
la commission des Affaires internationales au parlement, il affirme: “Dix
ans après l’agression et en dépit de l’embargo,
l’Irak est toujours fort sur les plans politique, économique et
militaire. (...) L’Administration américaine doit réviser sa
position et traiter sur d’autres bases avec l’Irak qui restera un
acteur-clé dans la région”. Oui, l’Amérique et
le monde occidental sont, désormais, conscients du fait qu’une
nouvelle politique doit être adoptée vis-à-vis de
l’Irak. Mme Madeleine Albright, secrétaire d’Etat
américain sortante, l’a souligné à son successeur, le
général Colin Powell. Le “dialogue global” prévu
pour février entre Bagdad et l’ONU, apportera-t-il des changements
notables au niveau des sanctions imposées par la communauté
internationale? Le proche avenir en donnera la réponse et
l’évolution de la conjoncture au Proche-Orient devant être
prise en considération. |