New York craignait la terreur; elle est surprise
par une gigantesque panne de courant
11 septembre 2001-15 août 2003. Rien de comparable entre ces deux dates, à part les embouteillages monstres et la marée humaine sur les ponts de New York, un savoir-faire acquis des policiers de la ville et l’autodiscipline des citoyens déjà aguerris contre l’épreuve. A vrai dire, ils craignaient la terreur anonyme ciblant encore une fois le centre économique des Etats-Unis et ils étaient loin de penser qu’ils connaîtraient le 14 août à 16h10 la plus gigantesque panne électrique de leur histoire qui les plongeraient dans le noir pour la cinquième fois.

|
Ils n’étaient pas les seuls avec leurs banlieusards dans l’épreuve. Celle-ci était partagée par 50 millions d’Américains et de Canadiens, plongés dans le noir dans huit Etats sur 9.300 km2 depuis le nord-est des Etats-Unis jusqu’au sud du Canada, en passant par la région des Grands Lacs, touchant les villes de New York, Detroit, Cleveland, Buffalo, Albany, Toronto et Ottawa. Le premier choc passé, ayant dévalé à pieds les interminables escaliers de leurs gratte-ciel, évacué avec frayeur les rames de métro ( 350.000 passagers à New York sur 7 millions d’usagers quotidiens, alors qu’ils sont un million à Toronto), jetés quasiment à la rue, au titre de sans-abri, privés de transports, accrochés à leurs portables et transistors.
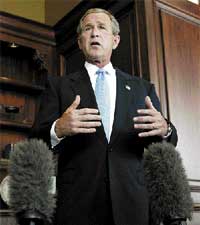 Le président Bush rassurant ses concitoyens: il ne s’agit pas d’un acte terroriste. |
|
 Marée humaine sur Brooklyn Bridge. |
29 heures plus tard
Ils ont été rassurés, le soir, par la voix du président
Bush qui leur parvenait de Californie: il ne s’agit pas d’un
acte terroriste. Il faut continuer à faire preuve de civisme. Egalement
réconfortant, le maire de New York, Michael Bloomberg qui s’est
déclaré certain “à 100% qu’il n’y
a absolument pas d’indication pour le moment qu’il y ait un
acte terroriste” et qui a octroyé à ses concitoyens
un jour de congé.
Ceux-ci se sont improvisés agents de circulation, ont choisi de
dormir à la belle étoile, sur les trottoirs, sur les marches
des monuments publics ou tout simplement dans les halls des gares à
l’instar de Grand Central à Manhattan. Les plus recherchés,
étaient les marchands de chandelles et de torches et bienvenus
les vendeurs de glace qui soldaient leurs délicieuses glaces à
un dollar, avant de devoir les jeter sur la chaussée en cette journée
d’été chaude et moite.
Les touristes, incapables de réintégrer leurs chambres d’hôtel,
ont partagé le sort des sans-abri, alors que des témoignages
de solidarité s’exprimaient un peu partout et que des artistes
venaient improviser des spectacles nocturnes. Pas de pillages à
déplorer (à part ceux d’Ottawa qui ont entraîné
une quarantaine d’arrestations), comme ce fut le cas, le 13 juillet
1977, où les dégâts avaient été estimés
à un milliard de dollars. Toutefois, deux victimes: un homme succombant
à une crise cardiaque et un policier blessé.
Alors que la zone atteinte était quasiment paralysée: sept
centrales nucléaires fermées, sept aéroports suspendant
leurs vols, les géants de la construction automobile à Detroit
(General Motors, Ford et Chryzler) fermant 54 usines... le courant allait
commencer à revenir progressivement vendredi matin dans certaines
régions de New York où le maire ouvrait le New York Stock
Exchange (NYSE). Broadway reprenait ses activités, Times Square
allumait tous ses feux, alors que le siège de l’ONU à
l’East River demeurait clos. Finalement, c’est 29 heures plus
tard que le courant a été partout rétabli. Lundi
matin, tout était rentré dans l’ordre. New York, Detroit,
Ottawa, Toronto commençaient une semaine fébrile, tenaillés
par une peur indicible, une nouvelle panne pouvant encore une fois tout
balayer.
 Sans-abri pour une nuit trouvant refuge à Grand Central station. |
|
 Times Square après le retour du courant. |
Changer un réseau “antique”
Quelles sont les causes de cette panne géante, unique dans l’histoire
du continent américain et qui devra entraîner des pertes
de l’ordre de 5 à 25 milliards de dollars? Avant de décider
de coopérer, les Etats-Unis et le Canada se sont rejeté
la responsabilité. Et les rumeurs les plus fantaisistes ont circulé.
On a pu soupçonner le virus informatique LovSan d’être
à l’origine de la panne; on a pensé aux chutes du
Niagara, à l’incendie d’un générateur
électrique en Pennsylvanie, enfin, ce qui semble actuellement plus
plausible, à une défaillance dans trois lignes de transmission
dans l’Ohio, au sud de Cleveland. Placé sous les projecteurs,
Spencer Abraham, secrétaire à l’Energie, a recommandé
la patience, étant donné que la panne met en cause des centaines
de milliers de lignes.
Le président Bush s’est hâté de dénoncer
un système “antique”, indiquant que cette panne géante,
la pire de l’histoire américaine, était une “incitation
au sursaut” et que “nous devons regarder ce qui n’a
pas fonctionné, analyser les problèmes et apporter une solution”.
Bill Richardson, gouverneur du Nouveau-Mexique et ancien secrétaire
à l’Energie sous le mandat de Bill Clinton, a dressé
ainsi un état des lieux: “Nous sommes une superpuissance
avec un réseau du tiers-monde”. Pour remettre celui-ci à
jour, les coûts sont estimés à 50-100 milliards de
dollars. Un projet de loi controversé sur la réforme de
l’énergie traîne déjà depuis dix ans
au Congrès. Le président Bush a décidé, à
la lumière des circonstances, de le geler.
Néanmoins, la Commission de l’Energie et du Commerce de la
Chambre des représentants a ouvert une enquête sur cette
gigantesque panne de courant, tandis que le secrétaire à
la Sécurité intérieure Tom Ridge et le vice-Premier
ministre canadien, John Manley, ont diligenté une enquête
pour en déterminer les causes et prendre des mesures préventives.
Selon des vues communément admises, la dérégulation
du marché de l’énergie, avec la production d’électricité
privatisée et une distribution restée publique, favorisent
une dichotomie propice à toutes les déréglementations.
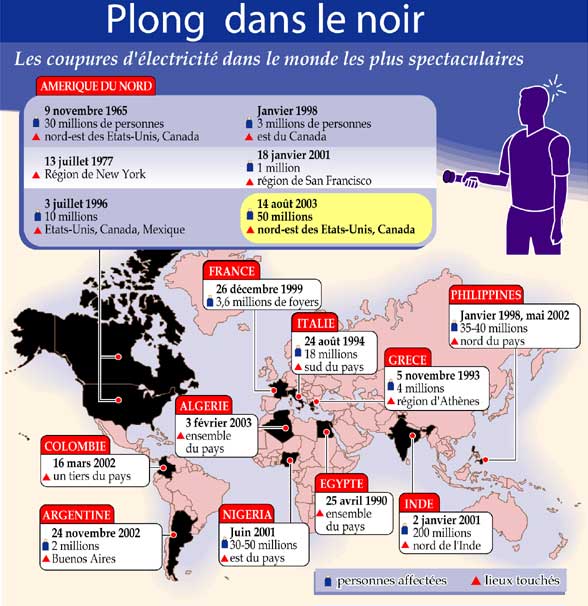
|
Le terroriste Hambali dans la nasse américaine
Les perturbations engendrées par la panne géante risquaient
d’occulter une grande victoire américaine dans la lutte antiterroriste:
la capture en Thaïlande de l’Indonésien Hambali, de
son vrai nom Riduan Isamuddin Hambali, chef opérationnel de la
Jamaa Islamya qui, sous l’impulsion de son guide spirituel Abu Bakar
Bachir, (actuellement sous les verrous), se propose de créer en
Asie du Sud-Est un Etat musulman de 250 millions de fidèles.
C’est de la base de l’armée de l’air de Miramar
en Californie, que le président américain a salué
l’arrestation de Hambali, appelé le Ben Laden d’Asie
du Sud-Est, “l’un des terroristes les plus recherchés
au monde”. Considéré comme le “cerveau”
des attentats de Bali (12 octobre 2002, 202 morts) et du Marriott à
Djakarta (5 août, 12 morts), en connexion avec al-Qaëda, il
serait impliqué dans les attentats du 11 septembre. Son épouse,
arrêtée avec lui, a été transférée
en Malaisie, son pays d’origine, alors que son propre lieu de détention
est tenu secret. Selon le Premier ministre malaisien, Thaksin Shinawatra,
Hambali était venu en Thaïlande “pour préparer
une attaque terroriste (...) contre le sommet du Forum de coopération
économique Asie-Pacifique (Apec) qui se tiendra les 20-21 octobre
à Bangkok et auquel participeront une vingtaine de chefs d’Etat,
dont le président Bush”.
Les Etats-Unis ont marqué un nouveau point dans la lutte antiterroriste
en arrêtant sur leur sol (avec deux de ses complices) un Britannique
d’origine indienne, Hekmat Lakhami qui tentait de vendre à
des islamistes un missile SA-18 Igla acheté à Saint-Pétersbourg
et qui a été en fait piégé par le montage
d’un scénario russo-américain engageant des agents
spéciaux russes et ceux du FBI.